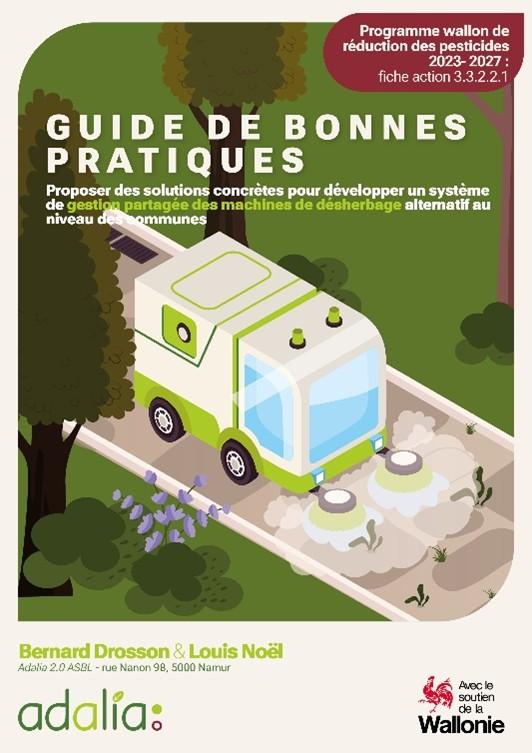
Une solution durable pour l’entretien des espaces publics
Depuis l’interdiction des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans les espaces publics en Wallonie en juin 2019, les communes ont dû repenser en profondeur la gestion de leurs espaces verts. Cette transition, bien que progressive, a nécessité des adaptations majeures, notamment en matière de désherbage. L’achat de machines alternatives aux pesticides représente un investissement conséquent, souvent difficile à assumer pour certaines communes, en particulier les plus petites.
Un défi partagé, une réponse collective
Face à ces enjeux, la mutualisation des équipements et ressources humaines entre communes apparaît comme une solution à la fois pragmatique et solidaire. Elle permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’améliorer la qualité du service rendu aux citoyens, tout en allégeant la charge de travail du personnel communal.
C’est dans ce contexte qu’Adalia 2.0, mandatée par le Service Public de Wallonie (SPW) dans le cadre du Programme Wallon de Réduction des Pesticides 3 (PWRP3), a mené une étude sur la faisabilité d’un système de mutualisation des machines de désherbage alternatif. Rapidement, cette réflexion s’est élargie à d’autres types de matériel, à des services, voire à du personnel.
Des initiatives déjà bien ancrées sur le territoire
L’étude a révélé l’existence de nombreuses initiatives locales de mutualisation. Ces expériences concrètes offrent des enseignements précieux pour les futurs projets. Elles démontrent que la réussite d’un tel système repose sur une adaptation fine aux réalités du terrain et sur une bonne connaissance des besoins locaux.
Deux modèles de mutualisation se distinguent :
-
La mutualisation « légère », via des marchés conjoints ou des prestations de services par une intercommunale. Ce modèle, accessible à un grand nombre de communes, permet de mutualiser les achats et de simplifier les démarches administratives.
-
La mutualisation « forte », impliquant le partage direct de machines ou de personnel. Ce modèle, plus exigeant en termes de coordination, s’avère particulièrement efficace lorsqu’un nombre restreint d’utilisateurs est assigné à chaque équipement. Il est notamment bien adapté aux communes rurales, par exemple pour la mutualisation de machines type “balayeuses”.
Un guide pratique pour accompagner les communes
Pour soutenir les communes désireuses de se lancer dans un projet de mutualisation, un guide de bonnes pratiques a été élaboré. Il propose :
-
Des points d’attention et recommandations concrètes ;
-
Des conseils pour rédiger une convention efficace ;
-
Plusieurs modèles de conventions prêts à l’emploi.
Au cœur du succès : l’humain
Au-delà des aspects techniques et logistiques, la réussite d’un projet de mutualisation repose avant tout sur la qualité des relations humaines. Une communication fluide et transparente entre les partenaires, avant, pendant et après la mise en œuvre, est essentielle. Lorsque chacun s’investit pleinement, des projets inspirants et durables peuvent voir le jour.
Intéressé par la mutualisation ? Découvrez les ressources disponibles
Vous souhaitez lancer un projet de mutualisation dans votre commune ? Nous mettons à votre disposition les résultats complets de cette étude ainsi que plusieurs outils pratiques pour vous accompagner dans votre démarche :
- Le Guide de bonnes pratiques : conseils, points d’attention et recommandations pour réussir votre projet
- L'Étude complète
- Convention type – machine : modèle de convention pour le partage d’équipement
- Convention type – machine et ouvrier : modèle incluant le partage de personnel
- ROI convention : modèle de règlement d’ordre intérieur accompagnant une convention
Ces documents sont conçus pour faciliter la mise en œuvre concrète de la mutualisation et garantir une collaboration efficace entre communes.
Un article de Louis Noël et Bernard Drosson, conseillers techniques chez Adalia 2.0
